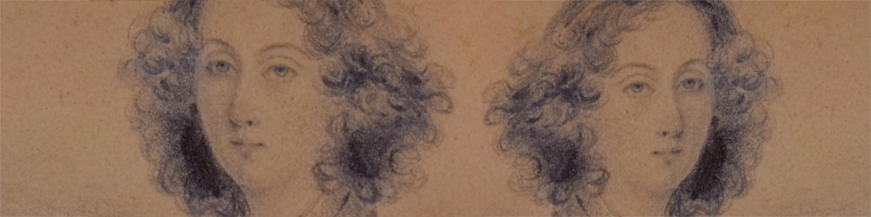|
Derniers moments et obsèques de George Sand
Souvenirs d’un ami (Henry Harrisse)
Nous étions tous très inquiets, nous communiquant les nouvelles que le docteur Favre envoyait à Alexandre Dumas et celles qu’Aucante adressait à Calmann Lévy, nos seules sources d’information sur l’état de la santé de George Sand, notre illustre amie.
Le jeudi, 8 juin 1876, en revenant d’accompagner Flaubert, chez qui nous avions trouvé une lettre de Martine et la copie au crayon d’une dépêche de M. Plauchut, laissée par Eugène Lambert, annonçant que Madame Sand était au plus mal, je reçus ce télégramme :
La Châtre, 4 hs, 46 m. du soir.
Ma mère est morte.
MAURICE SAND.
J’allai immédiatement communiquer cette triste nouvelle à Dumas. Il l’avait aussi reçue. Nous convînmes de nous prévenir mutuellement de l’heure et du lieu des obsèques pour nous y rendre ensemble.
Le lendemain matin, 9 juin, plusieurs journaux, les Débats entre autres, annonçaient que Madame Sand serait inhumée à Paris. Cette nouvelle parut invraisemblable. Effectivement, à huit heures un mot de Madame Dumas me prévenait que les obsèques auraient lieu à Nohant, et que son mari m’attendrait à la gare d’Orléans, le jour même, à dix heures du matin. Je fis préparer ma valise à la hâte. Le temps était affreux ; une pluie fine, serrée, froide, des rafales d’un vent âpre ; on se serait cru en octobre.
A la gare, je trouvai sept personnes venues dans le même but. Dumas arriva quelques instants après. Lui, Lambert, Paul Meurice, M. Edouard Cadol, Calmann Lévy et moi, nous prîmes place dans le même compartiment.
Nous arrivâmes à Châteauroux à trois heures et quart. La pluie ne cessait de tomber, le sol était complètement détrempé. Il n’y avait au débarcadère que la diligence et les deux pataches qui desservent habituellement la route de La Châtre, et déjà au complet. Grâce à un ami de collège de Dumas, le capitaine Cadet de Vaux, je trouvai chez un carrossier une espèce de berline que je louai pour deux jours, et à quatre heures nous nous mîmes en route pour Nohant, préparés à coucher dans quelque auberge de rouliers, faute de mieux.
A sept heures du soir nous étions à Nohant. On finissait de dîner. Nous attendîmes dans le jardin.
Le docteur Favre vint à nous, et prenant Dumas à l’écart, il lui raconta dans les plus grands détails la maladie et la mort de notre pauvre amie.
Maurice, son fils, ne tarda pas. Il se jeta dans mes bras. Je le trouvai changé, vieilli, les cheveux presque blancs. « C’est plus que la moitié de moi-même que je perds », me dit-il.
Madame Lina, sa femme, prévenue de notre arrivée, nous fit servir immédiatement à dîner. Pendant que nous étions à table, Maurice vint et, apercevant Dumas, lui passa les bras autour du cou, l’embrassant avec effusion.
A ce moment, on apporta une dépêche de Paris. C’était la Société des gens de lettres qui priait Dumas de vouloir bien prononcer un discours au nom de la Société. Il déclara n’en vouloir rien faire, n’étant pas membre de cette association, et pensant, fort justement, qu’elle aurait pu envoyer une délégation spéciale, ou tout au moins un représentant.
Etaient installés au château, outre les hôtes habituels, Madame Clésinger (Solange Sand) qui, prévenue de l’état désespéré de sa mère par une dépêche de son notaire, était venue de Paris en toute hâte, des parents : Oscar Cazamajou, Madame Simonnet, Edme, René et Albert Simonnet, le docteur Favre, MM. Aucante, Amic et Plauchut, amis de Madame Sand.
Boutet, le factotum de Madame Sand à Paris, qui était logé dans les environs, voulut m’emmener ; mais Madame Lina avait eu la bonté de prier le docteur Pestel de vouloir bien m’accueillir dans sa belle résidence de Saint-Chartier. A dix heures, par une nuit noire et une pluie battante, je m’y rendis, en compagnie de Paul Meurice et de Calman Lévy, qui devaient également y demeurer.
Nous restâmes à causer avec le docteur Pestel jusque près de minuit. Comme notre hôte avait constamment soigné Madame Sand pendant sa maladie, je le priai de nous raconter les derniers moments de cette femme aussi bonne qu’illustre.
Le lendemain j’interrogeai les principaux témoins de sa mort, afin d’en fixer le récit, estimant que les détails de cet événement ne seraient pas sans intérêt pour les amis et les admirateurs du merveilleux écrivain que fut George Sand.
Les réponses de ces témoins furent comparées et soumises à un contrôle minutieux. De retour à Paris, je mis en ordre les renseignements que j’avais recueillis, et envoyai au docteur Pestel les résultats de mon enquête, en le priant de s’assurer de leur parfaite authenticité.
Après avoir lu le manuscrit avec attention, il me le renvoya complété par des notes que j’ai utilisées dans les pages qui suivent, plusieurs fois en me servant de son langage même.
* * *
Madame Sand, à la suite d’une fièvre typhoïde contractée vers 1856, et qui avait laissé des ulcérations, souffrait souvent de violentes douleurs intestinales. Parlant peu d’elle-même, ne se plaignant presque jamais, ne voulant pas attrister ses enfants par la visite du médecin, elle n’avait recours à lui que lorsqu’elle ne pouvait s’en dispenser, préférant choisir ses remèdes.
Pendant tout le printemps, sa santé avait été bonne : mais depuis quinze jours l’atonie des organes était complète. Cependant, elle se préparait à quitter Nohant pour un séjour d’un mois à Paris, et devait partir le 3 juin. Le 30 mai, la maladie fit soudainement explosion.
Vers les trois heures de l’après-midi, Madame Sand, à la suite d’un médicament qu’elle avait pris le matin sur les conseils d’un jeune médecin de La Châtre, se sentit très mal. Appelant sa femme de chambre, elle lui dit d’aller chercher Maurice, qu’elle n’en pouvait plus et souffrait horriblement. Son fils la trouva étendue sur le canapé, en proie à de vives douleurs.
Lorsque, une heure après, Madame Lina rentra d’une noce de village où elle était allée avec ses fillettes, Madame Sand se plaignit de fortes souffrances et de nausées. Les douleurs allèrent en augmentant, des vomissements survinrent et à huit heures on envoya chercher son vieil ami, le docteur Papet. Dès qu’il l’eut examinée, il dit à Maurice : « Elle est perdue ! » Il passa la nuit à Nohant. Cette nuit fut atroce pour la malade ; elle poussait des cris qu’on entendait du fond du jardin.
Le lendemain matin on fut quérir le docteur Pestel. Il jugea la situation tellement grave que la présence d’un médecin de Paris lui parut nécessaire. Maurice répondit qu’il allait télégraphier au docteur Favre de venir. Le docteur Pestel voulait qu’on adjoignît à ce dernier un médecin d’une science pratique incontestée. Et comme Maurice dit n’en pas connaître, on lui désigna Barth ou Jaccoud. Le lendemain 1er juin, le docteur Favre arriva seul, n’ayant pu amener un des deux médecins désignés. Il repartit immédiatement pour Paris avec le mandat d’envoyer sans tarder un chirurgien, M. Péan ou un autre. Ce même jour, Madame Lina avait télégraphié au docteur Darchy, l’ancien médecin de Madame Sand, qui habitait dans la Creuse, de venir. Avant de quitter Nohant, le docteur Favre, dont le zèle et le dévouement ne se démentirent pas une minute, voulut être porteur d’une note explicative de la maladie, pour le docteur Péan. Ce fut le docteur Pestel qui la rédigea.
Le 2 juin, les docteurs Péan et Drachy arrivèrent et l’opération fut pratiquée dans l’après-midi. Elle souffrit le martyre stoïquement : la sueur ruisselait de son front.
On télégraphia alors au docteur Favre de revenir. Il revint par le premier train.
La fièvre disparut ; les docteurs Péan et Favre retournèrent à Paris, le dimanche 4 juin, croyant la pauvre malade sauvée.
Ce qui surtout la préoccupait, l’humiliait, c’était la nature de son mal : comme l’hermine elle serait morte d’une tache. Très souvent, elle répéta : « Que Maurice ne me voie pas souffrir ; épargnez-lui cette peine, et que les petites ne viennent pas. » La nuit suivante, voyant le docteur Pestel se pencher sur son oreiller, elle lui dit, le tutoyant pour la première fois : « Mon pauvre petit docteur, que tu es bon ; je te remercie… Pourquoi rester ? Une si vilaine maladie ! » Et c’est pour que ses enfants et ses amis ne pussent en voir les traces, qu’elle les éloignait de son chevet.
Cependant, le 7 juin au matin, Madame Lina qui veillait l’ayant entendue murmurer : « Adieu, mes chères petites filles ! » lui dit : « Veux-tu qu’on aille les chercher ? – Oui », répondit-elle. Les enfants vinrent et s’approchèrent du lit. « Mes chères petites, leur dit-elle, que je vous aime ! Oh ! mes adorées, je vous aime ! Je vous aime ! » Et elle répétait ces paroles à travers ses halètements de douleur.
Pendant sa maladie, Madame Sand parla très peu. Mais dans la nuit du 7 au 8 juin, on lui entendit fréquemment répéter d’une voix affaiblie : « Mon Dieu, la mort, la mort ! »
Cette nuit, elle éprouva de grandes souffrances. Il fallait à tout instant la relever dans son lit et la changer de position. Le docteur Pestel, Madame Clésinger et la dévouée Solange Marier ne restèrent pas deux minutes sans être occupées soit à la mouvoir, soit à la faire boire. Vers une heure du matin, elle voulut être lavée. En vain on lui représenta que ce serait une secousse inutile et pénible. Elle insista jusqu’à ce qu’on lui obéit.
Sur les trois heures du matin, Maurice, marchant sans bruit, se présenta sur le seuil de la porte. Madame Sand le vit aussitôt et s’écria : « Non, non, va-t’en. »
A plusieurs reprises elle dit à ceux qui l’entouraient : « Ayez pitié, mes enfants ; ayez pitié ! » Vers six heures du matin, la malade cherchant du regard la lumière, Madame Clésinger changea la direction du lit de façon que sa mère eût la fenêtre en face.
Il y avait à ce moment près d’elle : Madame Lina, Madame Clésinger, René Simonnet, M. Cazamajou et le docteur Favre. Le docteur Pestel s’était éloigné à quatre heures, jugeant d’après le pouls de la malade que l’existence se prolongerait pendant vingt-quatre heures environ. Tout à coup, elle dit d’une façon à peine intelligible : « Adieu, adieu, je vais mourir. Adieu Lina, adieu Maurice, adieu Lolo, ad… », voulant certainement ajouter : adieu Titite, mais elle ne le put. Puis elle murmura peu après : « Laissez verdure. » Quelques instants s’écoulèrent, puis elle prit la main de Solange et la porta à sa bouche en faisant le simulacre de mordre. Sa fille lui demanda si elle voulait manger. Elle fit signe que oui. On lui fit avaler péniblement une ou deux petites cuillerées de bouillon. Alors le regard devint fixe et terne, la respiration laborieuse, et elle s’éteignit ainsi à dix heures du matin.
Au moment où elle allait expirer, Madame Lina, Solange, MM. Simonnet et Cazamajou s’étaient agenouillés auprès de son lit. Le docteur Favre fit de même. Dès que la malade eut rendu le dernier soupir, le docteur Favre se redressa, et levant la main au-dessus du corps de George Sand, il dit avec force : « Tant que je vivrai, votre mémoire ne sera jamais souillée. »
George Sand, baronne Dudevant, née Lucile-Aurore-Amandine Dupin de Francueil, née à Paris, rue Meslay n°15 (19 actuel), le 12 messidor an XII (1er juillet 1804), mourut en son château de Nohant (Indre), le jeudi, 8 juin 1876, à dix heures du matin, dans sa soixante-douzième année.
La veille, 7 juin, vers neuf heures du soir, il n’y avait près d’elle à ce moment que sa fille et sa bru lorsqu’elles entendirent prononcer ces mots : « Adieu, adieu, je vais mourir », puis plusieurs paroles inintelligibles, finissant par : « Laissez verdure. » Solange regarda Madame Lina, comme pour lui dire que sa pauvre mère n’avait plus ses facultés ; mais en y réfléchissant, voici l’interprétation qu’elles donnèrent à ces deux mots :
Il y a dans le cimetière de Nohant, à l’angle de droite, appuyé au mur mitoyen qui le sépare du château, un petit enclos réservé, tout recouvert de broussailles et de plantes folles qui cachent la tombe du père et de la grand’mère de Madame Sand. Quand on entre dans cet enclos, on remarque une croix en marbre blanc, sans aucune inscription, et derrière cette croix, une stèle aussi de marbre blanc. Ces deux petits monuments funéraires furent érigés par Maurice et par Madame Clésinger lorsqu’on y inhuma les restes de son enfant, transférés de Paris, vers 1855, en l’absence de Madame Sand. Celle-ci, à son retour à Nohant, vit ces ornements tumulaires avec regret, ayant toujours préféré, dit-elle, au marbre, de la verdure pour des tombes.
D’après un des récits qui me furent faits, Madame Solange, lorsqu’elle arriva à Nohant, aurait trouvé, dans un petit sachet de satin bleu, un écrit de sa mère daté de 1857 ou 1858, qui commençait ainsi : « La mort n’étant pas un malheur, mais une délivrance, je ne veux sur ma tombe aucun emblème de deuil, je désire, au contraire, qu’il n’y ait que du gazon et des fleurs, des arbres et de la verdure. » Cet écrit aurait été déchiré peu après. Je n’ai pu contrôler ces détails. Mais lors des promenades que je fis avec Madame Sand, ou quand nous allions préparer un herbier des plantes mentionnées dans ses romans champêtres, il nous arriva plusieurs fois de passer devant cet enclos. Un jour que rentrant au château nous traversions le cimetière, Madame Sand s’arrêta un instant pour me fournir quelques détails sur ce lieu, en réponse à mes questions. Elle me donna alors à entendre que son désir serait d’avoir une sépulture cachée sous le feuillage comme celle de sa grand’mère. C’est évidemment à cette pensée que se rapportaient les paroles : Laissez verdure, qu’elle prononça la veille et le jour de sa mort.
* * *
Lorsque nous arrivâmes à Nohant, les restes de l’illustre défunte étaient déjà exposées, sur son lit, dans sa chambre à coucher, le visage tout couvert de fleurs. Dumas, montrant plus de courage que moi, voulut la voir une dernière fois. Il me dit en descendant que la main droite, mignonne et polie comme l’ivoire, seule n’éatit pas recouverte.
Ce fut Madame Clésinger qui, aidée de Solange Marier, pieusement donna aux restes de sa mère les derniers soins.
Elle passa dans la chambre mortuaire toute la nuit du 8 au 9 juin. Avec elle s’y rendirent successivement les jeunes Simonnet, le docteur Favre, Aucante, MM. Amic et Plauchut.
La nuit suivante, les servantes seules veillèrent ; la décomposition, hélas ! était tellement avancée, qu’elles durent se tenir dans le cabinet de travail adjacent. Mais quand on l’ensevelit, les traits de notre pauvre amie parurent bien moins altérés que la veille.
Le samedi, 10 juin, je descendis de bonne heure au salon du docteur. Je l’engageai vivement à mettre par écrit tout ce qui s’était passé sous ses yeux pendant la maladie de Madame Sand. Il me le promit.
A dix heures, mes compagnons et moi nous reprîmes, par une pluie battante, la route de Nohant, où nous déjeunâmes en compagnie du prince Napoléon, de Renan et de Flaubert, arrivés le matin même. Les amis, les invités, les curieux, des reporters envoyés par le Figaro et le Bien public, se promenaient dans le jardin. Ils discutaient la nouvelle qui venait de nous être communiquée que Madame Sand serait enterrée selon les rites de la religion catholique. Tout le monde parut étonné et on se demandait à qui il fallait attribuer l’initiative de cette cérémonie inattendue. J’allai aux renseignements.
Les parents et les amis de la famille croyaient que le testament contiendrait une clause formelle ordonnant des funérailles civiles ; non que Madame Sand affichât des sentiments anti-religieux ; mais son opinion sur les prêtres, ou plutôt sur le bas-clergé, était défavorable.
Dumas et Aucante, auxquels elle avait de son vivant confié d’importants papiers, ayant eu à interroger Me Ludre, son avoué à La Châtre, ou Me Moulin son notaire, sur les dernières dispositions de la défunte à l’égard de ces documents, apprirent que, par un codicille, la garde leur en était maintenue. En même temps, ils furent informés que le testament ne renfermait aucune disposition déterminant la manière dont elle voulait être inhumée.
La question de l’enterrement fut alors agitée par les membres de la famille, auxquels vinrent s’adjoindre le Dr Favre, MM. Aucante et Plauchut.
Dès le 7 juin, dans la soirée, Madame Solange, prévoyant la fin prochaine de la malade, avait consulté MM. Simonnet et Cazamajou sur le mode d’enterrement qu’il conviendrait de préférer. Chacun d’eux lui répondit : « Mais je pense que ce sera un enterrement civil. » Telle n’était pas l’opinion de Madame Solange.
Un des amis de la famille donna son mot. Il dit que Madame Sand devait être enterrée civilement ; que ses opinions l’exigeaient ; que faire autrement serait lui aliéner tout le parti républicain ; que du reste Madame Sand était allée à l’enterrement civil de Sainte-Beuve, étant la seule femme qui s’y trouvât, que c’était là, de sa part, une sorte de déclaration.
Madame Solange lui répondit que d’abord Madame Sand n’était pas la seule femme qui se fût rendue aux obsèques de Sainte-Beuve : que si elle y était allée, c’était à cause de Sainte-Beuve et non de l’idée d’adhérer à un enterrement civil ; qu’au contraire, dans bien des circonstances sa mère s’était moquée de gens qui se faisaient inhumer ainsi ; dernièrement encore à l’occasion de l’enterrement civil à Châteauroux d’un nommé Patureau-Francœur.
Madame Lina répondit à Solange : « Madame Sand n’a jamais exprimé devant moi d’intentions à ce sujet. J’ai fait enterrer civilement mon père, parce que cela me regardait. Il s’agit de votre mère ; c’est à vous à régler cette question avec Maurice. »
Maurice inclinait pour un enterrement civil. Sa sœur lui demanda s’il avait des instructions de sa mère, il répondit que non. Elle insista alors pour que Madame Sand fût inhumée religieusement, disant que si elle eût désiré être enterrée civilement, disant, elle n’aurat pas manqué de le dire [sic].
La famille Simonnet, M. Cazamajou et le docteur Favre, qu’on croyait libre penseur, se rangèrent de cet avis. Il ne fallait pas, dirent-il [sic], par un enterrement civil, choquer les sentiments religieux de la population au milieu de laquelle Madame Sand avait toujours vécu et allait avoir sa dernière demeure.
Le docteur Papet, consulté, dit à Madame Solange que s’il y avait un enterrement civil, ni lui ni sa famille ne s’y rendraient.
Sur les instances du docteur Favre, Maurice consentit à un service religieux. Et lorsque, après la cérémonie funèbre, Papet vint prendre congé de Maurice, ce dernier lui dit, avec une grande émotion : « Es-tu content ? les choses se sont-elles passées selon ton désir ? – Oui, répondit le plus ancien et le plus fidèle ami de Madame Sand, je trouve que tout s’est passé pour le mieux. » Maurice lui serra la main avec effusion.
L’abbé Villemont, curé de Vic, connaissait Madame Sand personnellement. Il avait même récemment déjeuné et passé toute une après-midi au château, et pendant la maladie de notre amie il était venu chaque jour demander de ses nouvelles ; se promenant même dans le jardin, sous les fenêtres de la maison en lisant son bréviaire, avec l’espoir sans doute, qu’au moment suprême, elle le ferait demander. Bien que Madame Sand eût conservé toute sa raison, elle ne dit pas un mot à ce sujet. Si elle avait manifesté le désir de voir un prêtre, le respect de son fils et de sa bru pour toutes ses volontés était tel, que, malgré leur sentiment à cet égard, ils n’eussent pas hésité à y obéir. D’autre part, MM. Aucante et Plauchut éloignèrent l’abbé Villemont, pensant que sa présence à Nohant, si elle était connue de Madame Sand, ne pourrait que l’attrister sans la décider jamais à recourir à ses bons offices.
Aussi lorsque Solange, après qu’elle lui eut fermé les yeux, demanda pour le corps de sa mère l’entrée de l’église à l’abbé Villemont, celui-ci ne crut pas devoir l’accorder avant d’en avoir obtenu la permission de l’archevêque de Bourges. De là un échange de dépêches télégraphiques de Solange avec le cardinal de la Tour d’Auvergne, qui n’hésita pas à accorder l’autorisation demandée.
Sur ces entrefaites, il se produisit un contretemps. La bière en plomb envoyée de Paris s’étant trouvée trop petite, on avait été obligé d’en faire venir une autre, laquelle n’arriva que très peu de temps avant l’heure fixée pour les obsèques.
Vers les onze heures et demie, le cercueil fut descendu dans le vestibule du château, et exposé une heure durant recouvert d’un drap mortuaire à croix d’argent. lorsque je m’approchai, la cour était presque remplie de paysannes, la tête couverte de leur capeline, et je crois en avoir vu plusieurs asperger la bière d’eau bénite. Marie Caillaud se trouvait à la gauche du cercueil, distribuant des brindilles de laurier, en guise de buis, à tous ceux qui s’approchaient.
Entre midi et demie et une heure, le corps fut levé et porté à bras dans la petite église par des paysans vêtus d’un sarreau bleu. Ils étaient précédés du prêtre, homme encore jeune. Derrière lui, venait un vieillard en blouse, qui portait un cierge et psalmodiait. Le prince Napoléon tenait d’une main un des cordons du poêle et de l’autre une des petites branches de laurier.
Le convoi entra dans l’église ; mais comme elle était déjà presque remplie, par des paysannes, ceux qui suivaient ne purent s’y placer, et refluant au dehors, ils vinrent se mêler aux villageois et à quelques ouvriers venus de La Châtre, qui se tenaient sur la place, tête nue, par la pluie et le vent. Il y avait en tout environ deux cents personnes. Nous remarquâmes l’absence de Hetzel, de Marchal, de Charles Edmond et du directeur de l’Odéon.
La pluie ne cessait de tomber. On entendait de la place les chants et le service religieux, qui dura peu de temps. Sans attendre la sortie, j’allai au cimetière. Le nouveau caveau de l’enclos était béant. Commencé la veille, on venait à peine de le terminer. Des paysans et le maçon en admiraient la solidité et le ciment.
C’est une simple voûte en briques, construite au milieu du terrain réservé, et dont le sommet ne dépasse pas le niveau du sol. A la gauche de l’entrée du caveau, cachées sous des broussailles, sont, côte à côte, les dalles qui recouvrent les restes du père et de la grand’mère de Madame Sand. (Sa mère est enterrée à Paris.) Une des deux tombes s’étend un peu sous le mur qui sépare le cimetière de la cour du château. Un très beau cyprès couvre ces tombes de ses rameaux.
La porte de communication, récemment pratiquée dans le mur mitoyen, se trouvait ouverte. Vers une heure, la procession funèbre, précédée d’un enfant de chœur portant la croix, et du prêtre revêtu d’une étole violette très usée, franchit la porte et vint se placer près du caveau. Les autres assistants se répandirent dans le cimetière, mais les places les plus rapprochées échurent à des gens complètement étrangers.
Après quelques courtes prières, le prêtre, l’enfant de chœur et le chantre se retirèrent. Un homme assez âgé, que j’appris être M. Périgois, conseiller général de l’Indre et républicain très avancé, lut d’une voix émue un discours retraçant en termes dignes et justes la vie parmi eux de l’illustre défunte.
Paul Meurice alors s’avança et, à son tour, il lut, lentement, de solennelle façon, les pages que Victor Hugo avait envoyées. Ce style, ces phrases toutes faites qui ne signifient absolument rien, produisirent un médiocre effet. Flaubert, lui, trouvait cette prosopopée sublime, et il m’avoua l’avoir déjà lue trois fois, chaque fois y découvrant de nouvelles beautés. Le prince Napoléon et Renan n’y virent qu’une « affaire de procédé, à la portée de tout littérateur possédant un copieux lexique. »
Le prince s’était proposé de prendre la parole. Dumas, de son côté, avait passé une partie de la nuit à écrire un discours. Mais étant venus à penser qu’entre le clergé et Victor Hugo il n’y avait pas place pour eux, ils se turent.
Ce cimetière inculte, toutes ces paysannes enveloppées de manteaux, agenouillées et priant dans l’herbe humide ; le ciel gris, la pluie fine et froide qui vous fouettait le visage, le vent bruissant à travers le cyprès et se mêlant aux litanies du vieux chantre, me touchèrent bien plus que toute cette rhétorique. Et cependant je ne pouvais m’empêcher de dire, à part moi, que la nature, en ce triste moment, devait bien à George Sand un dernier rayon de soleil !
J’allais faire mes adieux à Maurice et à sa femme. Me prenant les mains, Madame Lina me dit : « Bien qu’elle ne soit plus, vous nous restez, n’est-ce pas ? »
J’étais tellement ému que je ne savais quoi répondre.
Je cherchai alors Aurore et Gabrielle, pour les embrasser avant de partir. Les chères petites étaient à la grille du château, au milieu d’une foule de pauvres venus de tous les environs, occupées à distribuer des aumônes, selon leur cœur et suivant la touchante coutume du pays.
HENRY HARRISSE
Septembre 1876.
(Cité en Annexe IV, dans Correspondance, tome XXIV, pp.654-672.)
|