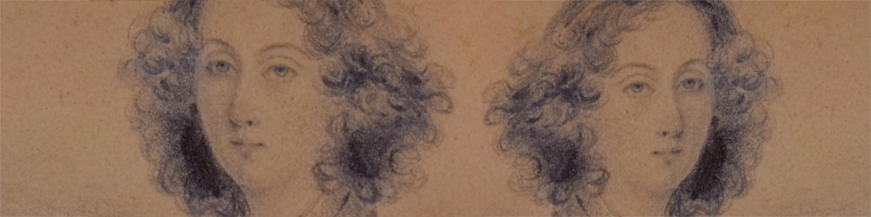|
Sainte-Beuve à l’Académie française
En théorie, ce serait un acte grave, patriotique et quasi religieux que la cérémonie dont nous avons été témoin : l’admission d’un nouveau membre à l’Académie française. Le corps vénérable représentant la doctrine publique l’individu, modeste et brave, venant lui faire hommage de ses idées nouvelles, car toute véritable intelligence est novatrice.
En théorie, le corps constitué, gardien des doctrines, offrirait à la fois au récipiendaire le trépied de la libre inspiration personnelle, et l’autel où son union avec la foi publique serait jugée sincèrement. Et il n’y aurait rien d’impossible dans ce contraste, le novateur ayant d’avance réagi assez sur l’assemblée et sur le sentiment public pour qu’il pût noblement, et sans se parjurer, faire serment de maintenir la foi publique épurée et éclairée par la lumière de son inspiration individuelle.
En pratique, il y a bien, sous un certain rapport, quelque chose de cela dans la réconciliation apparente qui se proclame entre le corps et le nouveau membre ; mais le lien qui se renoue entre eux embrasse si peu de chose que ce n’est guère la peine d’en parler.
C’est une réconciliation littéraire, et rien de plus. Qu’elle soit sincère, j’aime mieux le croire que d’en douter. Mais qu’elle soit très importante pour la gloire du siècle et du pays, il m’est bien permis de ne pas le croire.
Qu’importe au pays, en effet, que les divergences d’opinion sur la forme littéraire cessent à un moment donné dans l’enceinte de l’Institut ? Il y a tant de gens qui ne savent pas lire, qui n’ont pas de quoi manger, et qui, grâce à la paix féconde préconisée par le directeur de l’Académie, n’ont ni foi ni loi, en aucune chose, pas même en littérature ! Ces pauvres gens, c’est le pays, quoi qu’on en dise, et je demande ce que la majorité des Français a recueilli d’instruction à la querelle des classiques et des romantiques, ce qu’elle va gagner en bonheur intellectuel et matériel à la réunion de ces deux fameuses écoles sous la coupoles de l’Institut.
Camille Desmoulins et ses émules en ont plus appris à la majorité des Français que ne lui en apprendraient aujourd’hui quarante discours à propos de quarante fauteuils.
Est-ce à dire que l’Académie ne devrait parler que la langue du peuple, et à l’heure qu’il est, faire appel à de terribles nécessités ? Non, ce n’est point là sa mission. Mais il y aurait bien d’autres points de contact entre cette illustre assemblée et ce qu’on appelle sans doute là la populace, si nous ne vivions pas dans un temps de scepticisme et d’indifférence philosophique, où le littérateur croit tout au plus à a littérature, tandis que le peuple ne peut croire, lui, qu’à la misère et au désespoir.
D’où vient donc cet abîme qui sépare l’ignorance de l’art, la gloire du néant intellectuel ? Pourquoi ce sanctuaire dont le peuple ignore jusqu’à l’existence, lui qui ne connaît les royautés que par le mal qu’elles lui font, et qui ne connaît pas l’Académie vu qu’elle ne lui fait pas de bien ? Demandez au cocher de louage, voire à votre cocher si vous en avez un à vous, ce que c’est que cet édifice où il vous mène. C’est, vous dira-t-il, u endroit où il y a des livres. Il ne sait pas seulement s’il y a là des hommes.
Pourtant, nommez-lui quelques uns de ces hommes, il les connaît ; car ces hommes ont écrit des pièces qu’il a vu jouer, des livres qu’il a peut-être lus, des vers dont le refrain a frappé son oreille.
Ce ne sont pas les travaux habituels des lettrés qui sont étrangers et indifférents au peuple ; c’est le sens, le but et l’effet de cette constitution de la république des lettres, qui sont pour lui des énigmes, et que vous ne pourrez jamais lui expliquer sans qu’il vous réponde, dans son rude bon sens : « A quoi cela nous sert-il ? »
Et, en effet, à quoi cela est-il bon ? Est-ce une récompense pour le talent ? Toute récompense sociale devrait être utile à qui la donne autant qu’à qui la reçoit. Autrement, c’est une aumône, un hospice ouvert par la charité publique.
Et pourtant, ce ne sont pas des invalides qui se présentent, ce sont des hommes dont le talent fait l’honneur de la France. D’où vient que leur réunion ne produit rien de grave, et que, de la fusion de ces intelligences ne résultent que de stériles travaux sur la langue, laquelle va son train, se moque des dictionnaires, et progresse ou se pervertit quand même, sûre de les entraîner un jour ou l’autre ?
C’est qu’apparemment il n’y a point d’idée mère qui relie chacun de ces talents à tous les autres. C’est que la littérature, considérée seulement comme la forme de la pensée ne peut pas être une étude qui passionne des hommes intelligents. C’est que la vie n’est pas dans cette institution. C’est que ses statuts mêmes sont inféconds et se ressentent trop du passé. Une époque vivante et croyante saurait les rajeunir. Une foi politique et religieuse serait l’âme d’une assemblée d’hommes supérieurs. Elle y attirerait tous ceux qui le sont, elle en repousserait tous ceux qui ne le sont pas. Elle réagirait, par le sentiment et les idées, sur ces formes académiques, dont la qualification proverbiale est le synonyme d’inutile et de compassé. Elle rendrait les discussion sincère, animées, instructives, profitables, et ce serait là l’enseignement de tous les artistes, de tous les poètes, de tous les écrivains, du public par contrecoup, c’est-à-dire du peuple, et le peuple apprendrait la langue française, du moment que la langue représenterait autre chose que le culte des mots.
En attendant, on peut s’écrier, à la lecture ou à l’audition de la plupart de ces beaux discours : words, words, words !
M. Sainte-Beuve a fait un tour de force en prononçant un discours plein de charme et d’intérêt. Il fallait entendre surtout sa manière naturelle, son tond e causerie, accentué sans déclamation et animé sans emphase, un laisser-aller modeste et de bon goût, qui sauvait ce que son style a parfois d’obscur à force d’être délié. Ce style, plein d’idées et de nuances délicates, a pourtant un défaut très rare, indice d’une esprit qui approfondit peut-être trop son sujet et d’un doute intérieur consciencieux, mais excessif. Nous voulons dire le défaut de laisser du vague dans la pensée et de souffrir diverses interprétation de la même sentence. Tout l’éloge bibliographique de Casimir Delavigne a été charmant. On ne pouvait rendre plus aimable et plus touchante la jeunesse de caractère de ce poète exclusivement poète, incapable de faire des chiffres, se trompant de 9000 francs sur le prix d’un cheval et répondant avec naïveté aux observations : ce devait être un bien beau cheval ! En accusant le peu d’aptitude du poète à se mêler aux travaux de l’Académie, et s’engageant à le remplacer, sur ce point seulement, sans trop de désavantage, M. Sainte-Beuve a communiqué à l’auditoire un rire de sympathique et malicieuse bonhomie.
Le récipiendaire touchait, en parlant de la première manière de Casimir Delavigne, à une question jadis brûlante, aujourd’hui bien refroidie, la querelle des classiques et des romantiques. Il a sauvé avec une rare habileté tout ce que l’appréciation impartiale eût pu réveiller de ressentiments assoupis. Il y avait pourtant un courage caché sous quelques réflexions personnelles qui méritent d’être citées :
« Nous autres critiques qui, à défaut d’ouvrages, nous faisons souvent des questions ( car c’est notre devoir comme aussi notre plaisir), nous nous demandons, ou, pour parler plus simplement, messieurs, je me suis demandé quelquefois : Que serait-il arrivé si un poète dramatique éminent, de cette école que vous m’accorderez la permission de ne pas définir, mais que j’appellerai franchement l’école classique, si, au moment du plus grand assaut contraire, et jusqu’au plus fort d’un entraînement qu’on jugera comme on voudra, mais qui certainement a eu lieu ; si, dis-je, ce poète dramatique, en possession jusque-là de la faveur publique, avait résisté plutôt que cédé, s’il n’en avait tiré occasion et motif que pour remonter davantage à ses sources, à lui, et redoubler de netteté dans la couleur, de simplicité dans les moyens, d’unité dans l’action, attentif à creuser de plus en plus, pour nous les rendre grandioses, ennoblies et dans l’austère attitude tragique, les passions vraies de la nature humaine : si ce poète n’avait usé du changement d’alentour que pour se modifier, lui, en ce sens-là, en ce sens unique, de plus en plus classique (dans la franche acception du mot), je me le suis demandé souvent, que serait-il arrivé ?
« Certes, il aurait pu y avoir quelques mauvais jours à passer, quelques luttes pénibles à soutenir contre le flot. Mais il me semble – ne vous semble-t-il pas également, messieurs ? – qu’après quelques années, peut-être, après des orages bien moindres sans doute que n’en eurent à supporter les vaillants adversaires, et durant lesquels se serait achevée cette lente épuration idéale, telle que je la conçois, le poète tragique, perfectionné et persistant, aurait retrouvé un public persistant et fidèle, un public grossi, et bien mieux qu’un niveau paisible, je veux dire un flot remontant qui l’aurait pris et porté plus haut. Car ça a été le caractère manifeste du public en ses derniers retours, après tant d’épreuves éclatantes et contradictoires, de se montrer ouvert, accueillant, de puiser l’émotion où il la trouve, de reconnaître la beauté si elle se rencontre et de subordonner en tout les questions de genres à celles du talent. »
Quoi de plus élevé que ce jugement, et de plus digne d’un artiste que ce regret ? Pourtant, ce n’était pas le lieu et le moment d’accuser sévèrement Casimir Delavigne d’avoir manqué à la mission qui lui était tracée. Aussi M. Sainte-Beuve a-t-il vite sauvé l’allusion avec cette adresse et cette tolérance sans restriction qu’il faut apporter à l’Académie. Alors, la difficulté, l’impossibilité de son rôle de critique en pareille occurrence s’est fait sentir malgré tout son talent et son bon goût. Il a fallu ménager les vivants et les morts, respecter tous les efforts qui ont fait grossir le trésor commun ; bref, nous dire que tout chemin mène à Rome, c’est-à-dire à l’Académie. La conclusion est restée un peu vague, à force d’être richement habillée sous les formes du langage et la bonne intention de tout concilier. Nous espérons que M. Sainte-Beuve prendra ailleurs sa revanche, et qu’il n’abandonnera pas la défense de ses opinions littéraires. Mais nous nous disions en l’applaudissant : « Voilà donc à quoi sert le laurier académique ? à montrer, ne fût-ce qu’une fois en sa vie, que l’on peut être habile et contraint sous un air affable et dégagé ? »
Quoique ce discours de réception nous ait charmé en tant que travail littéraire, nous ne renonçons pas au droit de dire que certaines expressions appliquées au caractère et aux écrits du jeune auteur des Messéniennes ne nous ont point paru exactes. Dire qu’il appartenait alors à ces expressions mixtes, prudentes et sagement modérées qui sont celles de tous les bons esprits ne nous satisfait pas et nous persuade peu. Nous n’avons pas à juger ici la vie entière du poète, nous ne parlerons pas des opinions de son âge mûr.
Laissons-le dormir sous les lauriers dont on vient de couvrir sa cendre, elle appartient aux opinions de l’Académie, si toutefois l’Académie a des opinions. Nous ne la réclamons pas. Mais nous avons tous quelques droits sur sa vie, sur le souvenir que nous avons gardé de la jeunesse de son âme, de ses premières inspirations, qui nous ont remués aussi et bien vivement, jeunes que nous étions nous-mêmes alors. Le libéralisme de ce temps-là, c’était l’opinion avancée, l’esprit de liberté rajeuni au sortir de l’Empire. C’était, pour la majorité, le drapeau courageux et périlleux à porter. Il y avait bien des nuances dans le libéralisme ; puisque ni les débris de la Montagne ni M. de Chateaubriand ne reniaient cette qualification. Le libéralisme, c’était la résistance, et on n’y faisait pas trop de catégories. De tous ceux qui s’enrôlèrent, plusieurs ont marché en avant, d’autres se sont arrêtés. Nous ne parlons pas de ceux qui ont reculé. Mais qu’il y ait toujours lumière et vérité dans la prudence ou la lassitude, c’est un point très controversable, et qu’il nous est permis de ne pas adopter, nous qui regardons Socrate et Jésus-Christ, avec tout leur cortège de martyrs et de révolutionnaires, comme de très bons esprits, bien que leur libéralisme fût très peu mitigé et ne gardât nullement le milieu du pavé.
Nous ne ferons pas une longue guerre à M. Sainte-Beuve. Il n’est point, lui, un de ces esprits frivoles et superbes qui se raillent avec plaisir des douloureuses et sincères aspirations. Il est lui-même un douteur, sincère et mélancolique, et nous ne le flétrirons pas du nom de sceptique. Le sceptique par nature est froid et dédaigneux. Il ne peut pas croire parce qu’il ne peut pas aimer, parce qu’il ne peut pas comprendre. Il est vain et borné ; mais il est d’autres natures élevées et tendres qui arrivent à la négation par la souffrance, au dégoût par la facilité, à l’enthousiasme, à la fatigue par l’excès du travail et de la réflexion. Leur incertitude est une maladie dont ils peuvent guérir un jour, puisqu’ils ont eu la foi ; et s’ils n’en guérissaient pas, on devrait les respecter encore et les regarder comme une sorte de martyrs de la pensée. M. Sainte-Beuve tient à ce type-là, et si sa chagrine gaieté prend parfois le ton de l’autre, ceux qui le connaissent, au lieu de rire de sa malice, le plaignent de ce qu’il lui a fallu souffrir dans le secret de ses rêveries pour avoir tant d’esprit à propos de choses si sérieuses et si tristes.
Les esprits forts de notre temps aiment à répéter fièrement le « Que sais-je ? » de Montaigne. Je ne crois pas que Montaigne eût cette fierté-là quand il l’écrivit.
La sécurité du triomphe de Victor Hugo sur les résistances de l’Académie, et la sérénité de son front, nous laissent moins de scrupule, et nous ne craindrons pas de réveiller en lui le moindre regret en parlant de ses opinions présentes. M. Victor Hugo n’est ni un sceptique par impuissance ni un sceptique par déception ; ce n’est même pas un sceptique du tout, puisqu’il croit à la puissance de la phrase, à la régénération sociale par la métaphore, et à l’avenir de l’humanité par l’antithèse ; puisqu’enfin il lui plaît d’appeler ces choses-là du génie, et qu’il nous promet depuis longtemps à tous la lumière de la pensée, à la condition que nous croirons à l’importance première et absolue de la forme.
Nous ne sommes pas de ceux que la métaphore indigne et que l’antithèse révolte. M. Hugo s’en sert si bien, que, de très bonne foi, nous admirons sa manière sans conseiller à personne de l’imiter. On perd toujours le peu qu’on a en soi en voulant copier les maîtres, on ne prend que leurs défauts, et si nous allions tous parler par antithèse, nous serions fort maussades. Mais je demande qu’on laisse tranquillement M. Hugo parler comme il lui plaît, puisqu’avec sa tendance naturelle, ou son système arrêté, il parle admirablement. Loin de nous donc la pensée de contester son talent littéraire. Assez l’ont fait par jalousie. Il a eu parfois le droit de le contester et de traiter d’ennemis tous ceux qui ne l’admiraient as sans réserve. Tout grand artiste a ses originalités qu’il faut admettre, parce que en tant que grand artiste il fait une qualité de ce qui serait défaut chez tout autre. Le bon esprit de la critique consisterait peut-être à dire en pareil cas : « Laissez à cet homme ses théories si elles sont exclusives. Elles l’ont élevé très haut, mais elles vous feraient tomber très bas. »
Nous ne voudrions donc pas qu’on le dérangeât si souvent dans sa gloire de poète ; mais nous voudrions fort qu’on lui demandât ce qu’il entend par le génie, et qu’il daignât prendre un jour la peine de s’expliquer sur ce pouvoir mystérieux devant lequel, selon lui, l’humanité, consolée de tous ses maux, doit agenouiller en silence. Dans son discours à M. Saint-Marc Girardin, il avait déjà promis au récipiendaire monts et merveilles de son contact avec les intelligences académiques, des vues saines, des horizons immenses, une sérénité d’âme à toute épreuve, enfin tant de lumières et de consolations que le catéchumène en serait lui-même étonné. Si nous osions demander à M. Saint-Marc Girardin comment il se trouve à cette heure, peut-être nous apprendrait-il des choses étranges, des résultats miraculeux de son initiation.
Car enfin, cela serait bon à savoir, dans ces jours où l’on souffre tant, où la misère est si grande, les mœurs publiques si corrompues, l’honneur national si compromis. S’il ne s’agissait que de prendre d’assaut le palais de l’Institut et de s’asseoir sur les banquettes ( on dit fauteuils) du docte corps, le peuple ferait une révolution, je le parie, pour sentir dans son âme, ne fût-ce qu’un instant, ces ineffables voluptés de la quiétude intellectuelle, et cette foi au génie des gens de lettres, qui doit régénérer l’espèce humaine.
Quant à moi, pauvret, je me suis demandé naïvement, en écoutant ces belles promesses, quels effets produirait sur moi le philtre académique ? Y a-t-il donc là-dedans une doctrine, une révélation, ou quelque chose comme le sommeil d’Épiménide ? Voyons, me disais-je, une fois que je me serai bien persuadé que Rousseau et Voltaire n’étaient bons qu’à faire le mal, que toute opinion hardie, tout désir de réforme sociale est une maladie enragée, que nous avons été bien vexés de voir le jardin des Tuileries mangé par les chevaux des Cosaques, mais qu’à force de courbettes devant l’étranger, on peut et on doit, à coup sûr, se préserver du retour d’un tel malheur ; que nous vivons, Dieu merci, sous un prince… (Voir aux éloges de rigueur décernés par tous les discours de réception) ; qu’enfin l’Académie est Dieu, et que tout écrivain passe à l’état de Dieu en s’y incorporant ; quand, en un mot, je me serai bien convaincu que, pour avoir été imprimé, je suis un penseur, une puissance, un génie, que m’arrivera-t-il et quel plaisir trouverai-je à cela ? Je n’ai jamais pu me le figurer, je l’avoue. Il s’élevait en moi des contradictions comme celles qu’on nous présente quand on nous demande, ce que nous autres rêveurs, nous ferons, dans l’humanité future, des vices du temps présent. A quoi nous sommes toujours embarrassés de répondre, puisqu’il nous faut supposer la disparition de ces vices, et que ceux qui les ont y tiennent trop pour souffrir qu’on parle de les extirper. Je ne pouvais donc venir à bout de me dépouiller du sentiment de ma simplicité, j’y tenais, je le confesse, et je ne me représentais en aucune façon l’état de l’âme d’un génie. Mais quoi, me dis-je, quand j’aurai le génie, j’aurai par cela même, la bonté, la commisération, le dévouement à l’humanité, l’abnégation de toute personnalité ; je ferai très peu de cas de mon génie. Les autres le verront, mais je ne l’apercevrai pas moi-même, tant je serai occupé affectueusement et douloureusement de tous les pauvres d’esprit qui sont dans l’univers. Toujours penché, les mains étendues, vers l’ignorance, la faiblesse, et le mal engendré chez mes semblables par l’erreur, je n’aurai d’autre souci que de les consoler, de les éclairer, de les redresser. Il faudra d’abord que je les relève à leurs propres yeux, tous ces mortels délaissés et avilis ; il faudra que je leur enseigne l’amour de l’égalité, et, pour ce faire, il faudra, de toute force, que je commence par m’annihiler moi-même devant ma doctrine. Car si j’allais débuter par leur dire : « Respectez-moi, adorez-moi, prosternez-vous devant le membre de l’Académie et devant l’Académie en masse », ils me riraient au nez et me demanderaient où je prends la liberté, l’égalité, la philosophie, la pensée, l’esprit de Dieu, toute ma prétendue puissance, toute ma prétendue inspiration… Là, je fus arrêté court au milieu de mon rêve, par des applaudissements enthousiastes, je demandai ce que l’orateur venait de dire, et sa phrase me fut répétée. Elle était belle et je l’ai retenue.
« Qui que vous soyez, voulez-vous avoir de grandes idées et faire de grandes choses ? croyez, ayez foi. Ayez une foi religieuse, une foi patriotique, une foi littéraire. Croyez à l’humanité, au génie, à l’avenir, à vous-mêmes. »
Et je me demandais en relisant cette belle sentence, si ce n’était pas un peu vague et s’il y avait autant d’ordre dans l’enchaînement des pensées que dans celui des mots ; foi religieuse – croire à l’humanité ? Bien, vous nous parlerez de Dieu sans doute une autre jour. – Foi patriotique – croire au génie ? Génie de qui ? A celui de la nation, ou à celui du roi ? à celui des Chambres, ou peut-être à celui de l’Académie ? – Foi littéraire – croire en soi-même ? Pardon ! cela n’est pas donné à tout le monde. Il faut pour cela passer académicien. Si c’est aux académiciens seulement que vous parlez, soit ! mais nous autres, si par malheur nous ne croyons pas en vous, que nous arrivera-t-il ?
Comme je rêvais encore, on applaudit encore, et M. Victor Hugo prononçait sa dernière sentence que j’applaudis, comme faisaient les autres. « heureux, disait-il, le fils dont on peut dire : ‘Il a consolé sa mère !’ Heureux le poète dont on peut dire : ‘Il a consolé sa patrie !’ ».
Oui, sans doute, cela est beau, et si c’est encore une antithèse, tant mieux ! elle est heureuse. Mais en m’en allant, je me demandais si la mission du poète se borne toujours et dans tous les temps à consoler, et si parfois il n’aurait pas mieux à faire qu’à prêcher la résignation à ceux qui souffrent, la sérénité à ceux qui ne souffrent pas ; si, en face des iniquités d’une époque comme la nôtre, il n’y aurait pas quelque part un fouet ou une verge à ramasser, surtout quand on sait si bien s’en servir pour confondre des ennemis personnels ; si enfin, le voyou, qui arrachait en 1830 un fusil de la main d’un soldat pour chasser une royauté, n’était pas aussi utile à l’humanité que le poète qui arrangeait un hémistiche pour consoler la Monarchie déchue. Bref, je m’en allais, répétant cette parole peu académique :
Bienheureux les pauvres d’esprit…
2 mars 1845.
|