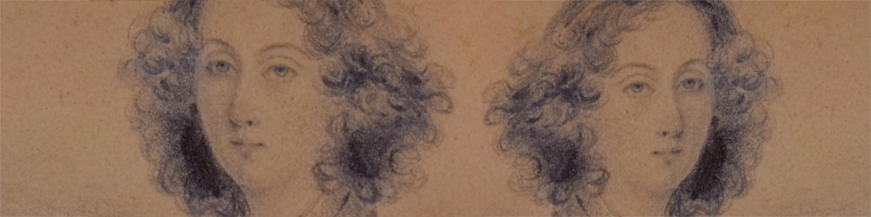|
Réponse de Sylvie Veys
Comme cette citation l’indique, George Sand n’a jamais voyagé en Orient, si ce n’est par la rêverie, l’imagination et à travers les représentations et récits de ses amis (Delacroix, Flaubert, son fils Maurice…).
Il y avait une grande mode orientalisante dans les années 1830, nourrie par les récits de voyages, les poésies de Hugo (1829) et les types littéraires des mystérieuses Orientales. George Sand n’échappait pas à cette mode : l’aménagement de la mansarde bleue, les accessoires vestimentaires, les babouches… et surtout le chibouque en témoignent. Musset dessina d’ailleurs Sand fumant le chibouque (voir le dessin ci-dessus). Ce goût orientalisant lui resta d’ailleurs toute sa vie : nous avons le témoignage « désespéré » de Nadar devant l’ameublement de l’appartement qu’elle occupa rue des Feuillantines à Paris en 1865 – 1866.
« L’ameublement en méchant reps algérien était plus que modeste et comme principal ornement du tout petit salon, un tapissier de journée avait appliqué aux murs quelques-uns de ces abominables dressoirs en découpages arabes d’un goût atroce, peinturlurés de bleu, de rouge et de jaune, plaqués de fausses dorures et supportant deux ou trois poteries kabyles aussi lourdes et laides que possible. » (cité par LUBIN Georges, Note sur les domiciles parisiens, dans Tome XIX de la Correspondance, p.912)
Le voyage en Italie, entrepris avec Alfred de Musset en 1834, est décisif : George Sand y approche de l’Orient, Venise étant considéré comme la porte magique vers cet au-delà rêvé. Venise, ville frontière entre l’eau, la terre, le ciel, mais aussi l’Orient et l’Occident. Sand y découvre les traces d’une culture qu’elle désire découvrir davantage. Les dômes byzantins, les nombreux Turcs qui vivent dans la cité vénitienne, tout lui donne envie d’en apprendre plus, tout l’intrigue. Elle fait de nombreuses références à l’Orient dans ses Lettres d’un voyageur, écrites dans la cité des Doges, comme en témoignent ces extraits :
« – Oui-da ! continua-t-il sans m’écouter ; savez-vous que dans mon temps j’ai été un célèbre chasseur de chamois ? Tenez, voyez-vous cette brèche là-haut, et ce pic là-bas ? figurez-vous qu’un jour…
– Basta, basta ! docteur, vous me raconterez cela à Venise, un soir d’été que nous fumerons quelque pipe gigantesque sous les tentes de la Place Saint-Marc avec vos amis les Turcs. Ce sont des gens trop graves pour interrompre un narrateur, quelque sublime impertinence qu’il débite, et il n’y a pas de danger qu’ils donnent le moindre signe d’impatience ou d’incrédulité avant la fin de son récit, durât-il trois jours et trois nuits. » (Première Lettre d’un voyageur, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, pp.653-654.)
« La lune montait dans le ciel, quand, après avoir dîné longuement, et longuement causé dans un café, nous arrivâmes à la Piazzetta. – Ce fils de chien dont la mère était une vache ne se dérangera pas, grommela Catullo, qui avait le vin misanthrope, ce soir-là. – A qui s’adresse cette apostrophe généalogique ? dit le docteur. En se retournant, il vit un Turc qui avait ôté ses babouches et une partie de son vêtement, et qui s’était agenouillé sur la dernière marche du traguet, si près de l’eau qu’il mouillait sa barbe et son turban à chacune des nombreuses invocations qu’il adressait à la lune. – Ah ! ah ! dit le docteur, ce monsieur a choisi un étrange prie-Dieu ; l’heure l’aura surpris au moment où il appelait une gondole ; il aura été forcé de se jeter le visage contre terre en entendant sonner le coup de sa prière. – Ce n’est pas cela, dit l’abbé ; il s’est mis là pour que personne ne pût passer devant lui et ne vînt à traverser son oraison ; son culte lui commande de recommencer autant de fois qu’il passe de gens entre lui et la lune.
En parlant ainsi, il mit sa canne en travers des jambes de Catullo, qui voulait poser brutalement le pied sur la rive et repousser le Turc pour nous faire aborder. – Laisse-le, dit l’abbé ; celui-là aussi est un croyant. – Et comment voulez-vous faire, dit le gondolier, si cet animal sans baptême ne se dérange pas ?
En effet, le traguet étant bordé de deux petites rampes de bois, nous ne pouvions aborder sans traverser quelque peu l’oraison du musulman. – Eh bien ! dit l’abbé, nous attendrons qu’il ait fini : assieds-toi, et ne dis mot. – Catullo alla s’asseoir sur sa poupe en secouant la tête ; il était facile de voir qu’il n’approuvait en rien les principes de l’abbé. – Qu’importe, dit celui-ci en se tournant vers nous, que la madone s’appelle Marie ou Phingari ? la vierge mère de la Divinité, c’est toujours la même pensée allégorique ; c’est la foi qui donne naissance à tous les cultes et à toutes les vertus. – vous êtes bien hérétique, ce soir, monsieur l’abbé, dit Beppa ; pour moi je n’aime pas les Turcs, non parce qu’ils adorent la lune, mais parce qu’ils tiennent les femmes dans l’esclavage. – Sans compter qu’ils coupent la tête à leurs esclaves, dit Catullo d’un air indigné. – Mon oncle, dit le docteur, a été témoin d’un fait que cette prière turque me rappelle. Un jour, il y a environ cinquante ans, un musulman fut surpris ainsi par l’heure de la prière, comme il se trouvait sur la rive des Esclavons. Il s’arrêta au beau milieu des quais, et commença, après avoir ôté ses babouches, les dévotions d’usage. Une troupe de polissons qui voyaient apparemment ce spectacle pour la première fois, se prit à rire, l’entourant avec curiosité, et répétant ironiquement ses génuflexions et le mouvement de ses lèvres. Le Turc continua sa prière sans paraître s’apercevoir de cette raillerie. Les polissons, encouragés, redoublèrent de singeries, et peu à peu s’enhardirent jusqu’à ramasser des cailloux et à les lui jeter au visage. Le croyant resta impassible ; sa figure ne trahit pas la moindre altération, et il n’omit pas une parole de son oraison. Mais, quand elle fut finie, il se releva, prit par le cou le premier petit malheureux qui lui tomba sous la main, et lui plongea son kandjar dans la gorge avec la même tranquillité que si c’eût été un poulet ; puis il se retira, sans dire une seule parole, laissant le cadavre ensanglanté à la place où sa prière avait été profanée. Le sénat délibéra sur ce meurtre, et il fut décidé que le Turc avait exercé une vengeance légitime. Il ne fut fait aucune poursuite contre lui.
Ce récit, que Catullo écouta, la tête penchée et l’oreille basse, parut lui inspirer un profond respect pour l’idolâtre ; car, quand celui-ci eut fini de prier, non seulement il attendit patiemment que celui-ci eût remis son dolman, mais encore il lui présenta ses babouches. Le Turc ne fit pas un geste de remerciement, ne parut pas s’apercevoir de notre politesse, et alla rejoindre ses compagnons, qui fumaient autour de la colonne de Saint-Théodore. – ceux-là sont des muscadins, dit l’abbé lorsque nous passâmes auprès d’eux. Ils n’ont pas fait leur prière. Ce sont des négociants établis à Venise, et que l’air de notre civilisation a corrompus. Ils boivent du vin, renient le prophète, ne vont point à la mosquée, et ne se déchaussent point pour saluer Phingari ; mais ils n’en valent pas mieux, car ils ne croient à rien, et ils ont perdu toute la poétique naïveté de leur idolâtrie, sans ouvrir leur âme à la vérité austère de l’Evangile. Cependant ils sont encore honnêtes parce qu’ils sont turcs, et qu’un Turc ne peut pas être fripon. » (Troisième Lettre d’un voyageur, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, pp.725-727.)
« Oui, j’ai été esclave, et l’esclavage, je puis te le dire par expérience, avilit l’homme et le dégrade. Il le jette dans la démence et dans le perversité ; il le rend méchant, menteur, vindicatif, amer, plus détestable vingt fois que le tyran qui l’opprime ; c’est ce qui m’est arrivé, et, dans la haine que j’avais conçue contre moi-même, j’ai désiré la mort avec rage, tous les jours de mon abjection. […] Ce n’est donc pas un incurable et un infirme qui est là devant toi ; c’est un prisonnier échappé et blessé qui peut guérir et faire encore un bon soldat. Ne vois-tu pas que je n’ai rapporté aucun vice de la terre d’Egypte, et que je suis encore sobre et robuste pour traverser le grand désert ? » (Sixième Lettre d’un voyageur, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, p.752.)
Dans l’esprit de la romancière, la notion d’esclavage reste indissociable de l’Orient. Néanmoins, elle désire visiter ces pays lointains et, probablement, se faire une idée par elle-même de cette culture si différente. Entre avril et juin 1834, alors qu’elle est à Venise avec Pietro Pagello (Musset étant rentré en France), elle évoque à plusieurs reprises son envie de partir pour Constantinople, ainsi qu’en témoignent plusieurs lettres du Tome II de la Correspondance, éditée par Georges Lubin. Il semble que seul le manque d’argent ait empêché ce voyage.
« J’ai le projet d’établir mon quartier général à Venise, mais de courir le pays, seule et en liberté. Je commence à me familiariser avec le dialecte. Quand j’aurai vu cette province, j’irai à Constantinople, j’y passerai un mois, et je serai à Nohant pour les vacances. De là, j’irai faire un tour à Paris et je reviendrai à Venise. » (Lettre du 6 avril 1834, à Jules Boucoiran, tome II de la Correspondance, p.577.)
« Je suis à Venise en attendant que j’aie l’argent et la liberté nécessaires pour aller à Constantinople. Mais je voudrais auparavant remplir mes engagements avec Buloz. C’est pourquoi je travaille du matin au soir. » (Lettre des 15 et 17 avril 1834, à Alfred de Musset, tome II de la Correspondance, p.564.)
« Pour le moment je serais bien aise de toucher une petite somme de 7 ou 800 francs, pour faire ce voyage de Constantinople, ou au moins pour me sentir le moyen de le faire, ce qui serait pour moi une pensée de liberté agréable au milieu de tout ce qui peut m’advenir de bon ou de fâcheux. » (Lettre du 29 avril 1834, à Alfred de Musset, tome II de la Correspondance, p.574.)
Malheureusement, et alors qu’Alfred de Musset essaye de la décourager de ce voyage qu’il juge trop risqué, Sand se voit forcée d’y renoncer, comme elle l’annonce :
« Il est trop tard pour que j’aille à Constantinople. Les chaleurs sont venues avant mon argent. J’irai dans une autre saison avec Pagello qui fonde avec raison peut-être des espérances de fortune sur ce voyage. » (Lettre du 24 mai 1834, à Alfred de Musset, tome II de la Correspondance, p.597.)
« Mon ami, à présent que je suis revenue de Constantinople, je te dirai que c’est un bien beau pays mais que je n’y suis pas allée. Il fait trop chaud et je n’ai pas assez d’argent pour cela. Si j’en avais j’irais à Paris tout de suite et non ailleurs. Si tu entends dire que je suis noyée dans l’Archipel ; sache donc bien qu’il n’en est rien et que c’est une nouvelle littéraire, rien de plus. » (Lettre du 1er juin 1834, tome II de la Correspondance, p.606.)
Sand ne fit jamais ce grand voyage en Orient, et un certain regret perce dans ses déclarations.
« Je ne puis, quelque chagrin que j’éprouverai à vous perdre pour longtemps peut-être, vous dissuader du voyage d’Egypte. Voyageur c’est apprendre, savoir, c’est exister. Vous n’irez pas en Orient et vous n’en reviendrez pas sans avoir acquis beaucoup de connaissances qui vous feront très supérieur à ce que vous êtes déjà. Les gens du monde et les femmes voyagent sans fruit, il n’en sera pas ainsi de vous. Vous observerez, vous verrez différentes races d’hommes, différents modes d’organisation sociale. Vous ne négligerez pas d’apprendre leur histoire si vous ne la savez déjà très bien, et d’examiner leurs penchants et leurs habitudes. » (Lettre du 12 avril 1835, à Adolphe Guéroult, tome II de la Correspondance, pp.853-854.)
Lors de son « Hiver à Majorque », George Sand fut une nouvelle fois confrontée, non pas avec les traces réelles de l’Orient, mais avec le souvenir laissé à dans l’île des Baléares. L’influence orientale sur l’architecture ou les chants la touche.
« Majorque est l’Eldorado de la peinture. Tout y est pittoresque, depuis la cabane du paysan, qui a conservé dans ses moindres constructions la tradition de style arabe, jusqu’à l’enfant drapé dans ses guenilles, et triomphant dans sa malpropreté grandiose, comme dit Henri Heine à propos des femmes du marché aux herbes de Vérone. Le caractère du paysage, plus riche en végétation que celui de l’Afrique ne l’est en général, a tout autant de largeur, de calme et de simplicité. C’est la verte Helvétie sous le ciel de la Calabre, avec la solennité et le silence de l’Orient. » (SAND George, Un hiver à Majorque, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, p.1039.)
Elle eut cependant l’occasion de voyager « par procuration », à travers les récits de proches. Edmond Combes (1758-1848), que Sand fréquentait, était parti en Orient en 1833 et avait publié plusieurs récits de voyage que la romancière possédait (Voyage en Abyssinie, Voyage en Egypte, en Nubie). Sand lui écrivit probablement plusieurs fois entre 1838 et 1848 (lettres perdues selon Georges Lubin). Mais c’est surtout à travers son fils qu’elle découvrit certains aspects de l’Orient. Entre mai et septembre 1861, Maurice Sand fait un grand voyage en bateau avec le Prince Jérôme Napoléon. Ils iront jusqu’en Amérique, mais découvrent également certaines cités orientales (Alger, Oran, Tanger). Il ramène de ce périple un carnet de voyage, des notes éparses, des dessins. De ces brouillons naîtra le récit « Six mille lieues à toute vapeur », signé Maurice Sand, mais à propos duquel Georges Lubin notait : « Il va falloir ajouter Six mille lieues à toute vapeur à la liste des œuvres de George Sand » (tome XVI de la Correspondance). En effet, il semble que Sand fit bien plus qu’aider son fils. A travers ses notes, ses dessins, en réécrivant grandement les brouillons, elle parcourut donc certaines villes d’Orient à travers les yeux de Maurice. Il semble que ce travail commun lui ait redonné l’envie de découvrir ces contrées à son tour. Manceau, le compagnon de George Sand, note dans leur agenda à la date du 3 février 1862 : «Madame pense aller en Algérie». Sand est également en correspondance avec Benoît-Simon, dit Fortuné Lapaine (1816-1867), préfet de Constantine, comme en témoigne la lettre suivante :
« Vous me dîtes des choses qui me frappent beaucoup, Monsieur, et qui me donnent autant d’envie de vous connaître que de voir l’Afrique. Vous comprenez ce que l’on doit aux vieilles races, vous sentez leur grandeur, et vous vous êtes sérieusement posé en face du grand problème. Ah oui, c’est le grand problème que la France seule doit arriver à résoudre, car jusqu’ici les autres nations ont presque toujours foulé, traqué, exaspéré ou détruits les vaincus. J’ai vu des Indiens, de beaux et fiers Indiens, à Paris, et j’avais envie de pleurer en songeant à la manière dont la prétendue civilisation américaine avait traité cette noble race. […] Oui, j’ai grande envie de voir l’Afrique et surtout la Kabylie et les Kabyles. Mais comment faire ? Je ne suis plus jeune, j’ai 57 ans. Je marche encore très bien, mais je ne monte plus à cheval, et j’ai besoin de certains soins à domicile. Le voyage à Constantine ne m’effraie pas et je sais que c’est un séjour hardi et pittoresque comme je les aime. Mais là, trouverai-je une habitation où je pourrai m’isoler tout à fait à mes heures, être un peu à la ville et un peu à la campagne, circuler dans une carriole de louage, vivre enfin en hermine qui se promène et retourne chaque soir manger, dormir et rêver chez lui, sauf quelques excursions possibles à quelqu’un qui ne chevauche plus ? Si vous étiez assez bon pour me dire la bonne saison de l’année entre le chaud et le froid, la dépense de quatre personnes par mois, (car nous sommes toujours quatre), la possibilité d’avoir nourriture et serviteurs de louage, ou d’aller manger tranquillement quelque part je verrais si mon très mince budget et mes forces automnales me permettent ce beau rêve. Je ne sais pas voir et sentir en courant, en causant toujours, en échangeant des visites, recevant des oisifs et des curieux, et un des attraits des voyages, c’est pour moi la solitude en famille. J’ai besoin de m’imprégner de la senteur d’un pays, de le voir du brin d’herbe au nuage, non pour tout dire, mais pour l’avoir compris et pour l’aimer. Il me faudrait donc deux ou trois mois de séjour à Constantine pour en parler, et en causant quelques fois avec vous, Monsieur, j’aurais la précieuse certitude de comprendre ce que j’aurais vu. Quand vous en aurez le temps, dites-moi donc si vous me croyez capable d’en voir assez avec cette manière de digestion intellectuelle si modestement paisible. Et vous me direz aussi ce que je dois lire d’avance sur l’histoire et les circonstances du pays, afin que je n’y arrive pas comme tombant de la lune. » (Lettre du 7 février 1862, à Fortuné Lapaine, Tome XVI de la Correspondance, pp.771-772.)
Ce voyage ne se fera finalement pas. Il est également intéressant de remarquer que Sand réclame le respect pour les cultures et les hommes des pays colonisés. L’exemple du génocide indien par les Américains l’a très fortement impressionnée.
A propos de Sand et l’Algérie, je vous renvoie aux articles suivants :
– DUPUY, A., L’Algérie à travers la vie et l’œuvre de George Sand et le sujet algérien. II. Les interventions d’affaires. III. Les interventions politiques, dans Journal des instituteurs de l’Afrique du Nord, 12-26 novembre 1956.
– DUPUY, A., George Sand et l’Algérie, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1955.Si, à la différence du Tyrol, l’Orient ne représente pas un idéal pour Sand (en partie en raison de l’assimilation avec l’esclavage des femmes et des faibles en général), cela reste néanmoins une destination vers laquelle elle rêve, qu’elle parcourt parfois en esprit.
« Peut-être es-tu au sommet de l’Atlas… Ah ! ce mot seul efface toute la beauté du paysage que j’ai sous les yeux. Les jolies myosotis sur lesquels je suis assis, la haie d’aubépine qui s’accroche à mes cheveux, la rivière qui murmure à mes pieds sous son voile de vapeurs matinales, qu’est-ce que tout cela auprès de l’Atlas ? Je regarde l’horizon, cette patrie des âmes inquiètes, tant de fois interrogée et si vainement possédée ! je ne vois plus que l’espace infranchissable !… » (Neuvième Lettre d’un voyageur, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, p.875.)
« Songe bien que je ne suis pas un serviteur bien éprouvé, moi ; j’entends déjà leurs lardons m’assaillir pour la singulière figure que je fais en habit de soldat de la république ; je t’en prie, mon cher maître, laisse-moi m’en aller à Stamboul. J’ai affaire par-là. Il faut que je passe par Genève, que j’achète un âne pour traverser les montagnes avec mon bagage, et que je remonte la Forêt-Noire pour chercher une plante que le Malgache veut que je lui rapporte. J’ai à Corfou un ami islamite qui m’a invité à prendre le sorbet dans son jardin. Duteil m’a donné commission de lui acheter une pipe à Alexandrie, et sa femme m’a prié de pousser jusqu’à Alep afin de lui rapporter un châle et un éventail. Tu vois que je ne puis tarder, que j’ai des occupations et des devoirs indispensables. »(Sixième Lettre d’un voyageur, dans Œuvres autobiographiques, Gallimard, Paris, 1971, tome II, p.816.)
L’Uscoque (1838) est le roman de George Sand dans lequel l’Orient est le plus présent. Il s’agit d’un récit populaire, dans la veine des romans à rebondissements de Sue ou Féval. A la fin du XVIIe siècle, une Vénitien ruiné arme un bateau pour aller s’attaquer aux Turcs. Après quelques succès et un brillant mariage, il est néanmoins capturé par les Turcs. Il est délivré par une jeune esclave, Naam, amoureuse de lui. Elle se travestit en homme pour le suivre dans ses péripéties et, sous le nom de l’Uscoque, le Vénitien devient pirate. Après beaucoup de mésaventures, l’Uscoque disparaîtra et Naam s’enfuit. Marielle Caors aborde ce roman « orientalo-vénitien » dans son étude George Sand de voyages en romans :
« Enfin, il convient de mentionner le personnage de Naam, la jeune esclave turque déguisée en garçon : si elle n’échappe pas aux clichés orientalisants – beauté, fatalisme, amoralité – elle apparaît comme une jeune femme ardente, entière, dévouée jusqu’au sacrifice tant qu’elle n’est pas bafouée et révoltée par la cruauté gratuite d’Orio envers Giovanna (habituée à la polygamie, elle n’éprouve pas de jalousie envers l’épouse de son amant). Elle renie alors jusqu’à sa féminité pour échapper à la cruauté masculine et meurt au Yémen sous les traits d’un ermite vénéré à l’égal d’un saint. » (CAORS Marielle, George Sand de voyages en romans, Royer, s.l., 1993, pp.49-50.)
J’espère que ces indications pourront vous être utiles. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien à vous, |